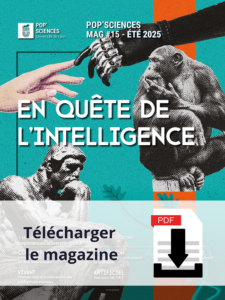Qu’ont en commun un enfant qui peine à suivre en classe, un adulte en reconversion, ou une personne en situation de handicap sensoriel ? Tous, à un moment donné, peuvent être concernés par une évaluation de leur « intelligence ». Mais que mesure-t-on vraiment dans ces tests ? Et à quelles fins ?
Par Marie Privé, journaliste.
>> Version à feuilleter en ligne : cliquez ici
>> Ou téléchargez le pdf du Pop’Sciences Mag #15 :
Les outils les plus connus, comme les échelles de Wechsler (WAIS, WISC…), sont utilisés depuis plusieurs décennies par les psychologues. « Ces tests évaluent différents aspects : compréhension verbale, mémoire de travail, raisonnement perceptif, vitesse de traitement…, explique Anne-Lyse Demarchi. On parle aujourd’hui davantage d’indices que de quotient global. » Un changement significatif : on tend de plus en plus à remplacer le QI « total » par une cartographie des compétences cognitives, plus fine et plus nuancée.
Ce que les tests disent (et taisent)
Mais ces outils ont leurs limites. D’abord techniques : « Les tests standardisés sont construits à partir de normes définies sur des populations cibles, rappelle Anna-Rita Galiano. Le problème n’est donc pas le test en lui-même, mais son utilisation hors de son cadre d’étalonnage, ou sans réelle formation aux fondements théoriques de la psychométrie[1]. » Dans certains cas – par exemple en présence d’un handicap sensoriel -, le format non modifiable des épreuves peut compliquer la passation, voire exclure certains profils si l’outil est mal appliqué. Deuxième limite : l’interprétation. « Les cliniciens n’utilisent pas ces tests pour obtenir un chiffre, mais pour comprendre un profil, précise Anne-Lyse Demarchi. Ce qui nous intéresse, c’est la façon dont la personne aborde les épreuves, les stratégies qu’elle mobilise, les incohérences éventuelles. » Un même score peut refléter des réalités très différentes selon l’histoire, le contexte ou les troubles associés.
Enfin, la question du cadre d’usage revient souvent : réalisés dans un cadre libéral, ces tests coûtent cher et prennent du temps ; en institution, les professionnels sont trop souvent débordés. « Passer un bilan complet demande environ trois heures, sans compter l’analyse, explique Anne-Lyse Demarchi. Et dans les institutions, même lorsqu’un psychologue est présent, il est souvent mobilisé sur des suivis psychiques, pas spécifiquement sur la passation de tests. Les ressources humaines sont donc rarement suffisantes pour mener des évaluations approfondies. » Les usages s’en trouvent restreints… et les résultats parfois surinterprétés. Et pourtant, la demande reste forte : pour poser un diagnostic (déficience intellectuelle, haut potentiel…), obtenir un accompagnement scolaire ou social, éclairer une décision judiciaire, ou simplement comprendre une difficulté d’apprentissage. « Quand je faisais des expertises psychologiques pour la Cour d’appel, il arrivait qu’on me demande si la personne avait les capacités intellectuelles pour se remettre en question, pour comprendre la gravité de ses actes ou pour se réinsérer dans la société, raconte Anne-Lyse Demarchi. Là, la notion d’intelligence prend un poids très concret. » Mais face à cette multiplicité des usages, faut-il continuer à chercher à tout prix à « mesurer » l’intelligence ?
Peut-être vaudrait-il mieux parler d’évaluer des compétences, de repérer des besoins, ou d’accompagner des singularités.
Notes
[1] La psychométrie est la science des mesures pratiquées en psychologie (incluant les modalités de validation et d’élaboration de ces mesures). Elle s’applique à tous les champs de la psychologie et à des domaines connexes (comme la recherche en comportement du consommateur).
POUR ALLER PLUS LOIN
- Intelligence(s) : un mot, mille visages, par Marie Privé, Pop’Sciences Mag #15, été 2025.