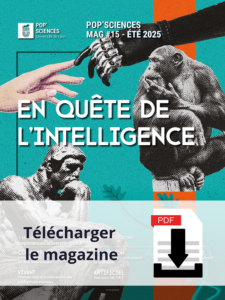De l’intellect des philosophes à la mesure du QI, de l’adaptation à la créativité, l’intelligence n’a cessé de changer de visage au fil des siècles. Derrière ce mot aux contours flous se cachent des choix culturels, des visions du monde… et parfois, des mécanismes d’exclusion.
Par Marie Privé, journaliste.
>> Version à feuilleter en ligne : cliquez ici
>> Ou téléchargez le pdf du Pop’Sciences Mag #15 :
Chacun pense la connaître… jusqu’à ce qu’il faille la définir. L’intelligence, cette capacité que l’on associe tantôt à la logique, tantôt à la créativité ou à l’adaptabilité, est omniprésente dans nos discours, mais étonnamment insaisissable. Est-ce une qualité innée ? Une performance mesurable ? Une aptitude à résoudre des problèmes, à comprendre autrui, à composer avec l’imprévu ? Le mot, en apparence familier, cache une constellation de sens. Selon les époques, les cultures, les disciplines, il a été défini, redéfini, contesté, élargi.
Un concept qui a traversé les siècles
En remontant le fil de son histoire, l’intelligence apparaît comme une notion étonnamment récente – ou du moins, comme un mot longtemps périphérique dans la pensée savante. « Dans la tradition philosophique, on parle bien plus volontiers de raison, de pensée, de jugement ou d’esprit. Le mot « intelligence », lui, ne prend vraiment d’importance qu’à partir du 20e siècle », souligne Jean-Michel Roy, professeur de philosophie et sciences cognitives à l’École normale supérieure de Lyon. Chez Aristote (4e siècle av. J.-C.), le noûs (l’intellect)[1] désigne une faculté de connaissance supérieure, tournée vers l’essence des choses. Chez Descartes (17e siècle), la raison est une lumière naturelle de l’âme, commune à tous les hommes, mais inégalement bien utilisée. L’intelligence, en tant que telle, n’est encore ni un objet scientifique, ni une réalité mesurable.
Il faut attendre le tournant des 19e-20e siècles pour que cette notion s’impose dans les milieux scientifiques. C’est l’époque de la psychologie expérimentale, de l’émergence des sciences de l’éducation, des premières tentatives pour quantifier les performances mentales. Le nom d’Alfred Binet (1857-1911), psychologue français, marque une étape clé : chargé de repérer les enfants en difficulté scolaire, il élabore une échelle destinée à « mesurer l’intelligence » – ou plutôt, à situer un enfant par rapport à une moyenne d’âge[2] . « Les premières mesures de l’intelligence ne naissent pas d’un pur intérêt théorique, mais d’un objectif pratique, institutionnel, rappelle Mathieu Guillermin, enseignant-chercheur en éthique des technologies à l’Institut catholique de Lyon (UCLy). On veut trier, classer, diagnostiquer. C’est là que l’intelligence devient une donnée. » Cette bascule est fondamentale : pour la première fois, on tente d’objectiver une capacité mentale complexe, en la traduisant en score. Le projet de Binet est pourtant nuancé : il insiste sur la plasticité de l’intelligence et met en garde contre les usages abusifs de son échelle. Mais son outil ouvre la voie à une logique de mesure, qui ne cessera de se consolider au fil des décennies.
Dans les années 1930, le psychologue David Wechsler perfectionne ces tests en intégrant de nouvelles dimensions – mémoire, compréhension verbale, raisonnement non verbal, vitesse de traitement… Il pose les bases du quotient intellectuel moderne, standardisé, normé, reproductible. Les échelles qu’il conçoit (WAIS pour les adultes, WIPPS et WISC pour les enfants) sont encore aujourd’hui les plus utilisées au monde. « Il a compris l’importance d’évaluer différents axes : mémoire, attention, compréhension verbale, rapidité, indique Anne- Lyse Demarchi, psychologue clinicienne, enseignante à l’Université Lumière Lyon 2. Cela permet de brosser un tableau général des compétences intellectuelles. » Mais dès lors, un débat s’installe. Peut-on vraiment résumer l’intelligence à une série d’épreuves ? Ne risque-t-on pas de confondre la capacité à réussir un test avec l’intelligence elle-même ? Dans les milieux philosophiques, ces questions trouvent un écho critique. « Le modèle qui s’impose au 20e siècle est très intellectualiste, explique Jean-Michel Roy. C’est-à-dire que l’on pense l’intelligence sur le modèle du raisonnement logique, formel, calculable. Or cette conception, héritée du cartésianisme, reflète une vision bien spécifique de l’intelligence, propre à une époque et une culture. »
C’est dans ce contexte que s’élève la voix de penseurs comme le philosophe Gilbert Ryle, qui dans les années 1940 remet en cause l’idée que penser consisterait à manipuler des symboles abstraits. Il défend au contraire une intelligence en acte, ancrée dans les usages et les habitudes. Plus tard, les philosophes Hubert Dreyfus[3] et John Searle[4] poursuivent cette critique, en montrant que l’intelligence humaine n’est pas transposable sur le modèle informatique : elle repose sur l’expérience vécue, l’intuition, la compréhension implicite. Ces critiques ne visent pas à abolir la notion d’intelligence, mais à en élargir le périmètre. Elles invitent à sortir d’une vision purement logico-déductive, pour reconnaître que l’intelligence peut aussi être motrice, relationnelle, contextuelle. Une remise en cause féconde, qui ouvre la voie aux approches contemporaines et aux débats qui les accompagnent.
L’intelligence… ou les intelligences ?
Définir l’intelligence est déjà un défi. Mais croire qu’elle se résume à une seule forme, valable en tout temps et en tout lieu, c’est passer à côté de sa complexité. Car derrière ce mot se cache une variété de conceptions, issues de traditions scientifiques et philosophiques parfois complémentaires, souvent concurrentes. « Dans les sciences cognitives contemporaines, on observe une sorte de pluralisation des modèles, mais aussi une réticence croissante à parler d’ »intelligence » au singulier », explique Jean-Michel Roy. Le terme est devenu trop flou pour décrire des capacités aussi diverses que mémoire, logique, créativité ou adaptabilité sociale. Cette pluralité n’est pas nouvelle. Depuis le début du 20e siècle, plusieurs chercheurs ont tenté de décomposer l’intelligence en « facteurs » ou « aptitudes », parfois organisés de manière hiérarchique (comme dans le modèle de Cattell-Horn-Carroll[5]), parfois présentés comme indépendants (comme dans la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner[6]). Dans les deux cas, l’intelligence devient un faisceau de compétences, variables selon les individus et les contextes.
Ce glissement suscite des résistances : certains y voient une dérive relativiste, ou une perte de rigueur. D’autres y lisent au contraire une reconnaissance salutaire de la diversité humaine. « Le mot intelligence est trop polysémique pour vraiment éclairer ce qu’on cherche à désigner, estime Jean-Michel Roy. Ce qui intéresse les philosophes, ce sont des capacités concrètes : juger, comprendre, raisonner… Le terme global, lui, finit souvent par masquer les nuances plutôt que les révéler. » Mathieu Guillermin va plus loin : « L’intelligence n’est pas un phénomène naturel qu’on pourrait mesurer comme on mesurerait une pression ou une température. C’est une catégorie culturelle, construite socialement, historiquement, symboliquement. » En d’autres termes : on ne découvre pas l’intelligence, on la fabrique – et ce que l’on choisit d’appeler ainsi dépend toujours de ce que l’on valorise.
Or, ces valeurs évoluent. Pendant longtemps, on a valorisé la rigueur logique, l’efficacité, la rapidité. « Aujourd’hui, dans un monde marqué par l’incertitude, la complexité, le changement rapide, observe Mathieu Guillermin, d’autres formes d’intelligence remontent à la surface : intelligence émotionnelle, pensée critique, capacité à coopérer, à improviser, à naviguer dans des environnements mouvants. » Elles reflètent ainsi de nouvelles priorités : plus relationnelles, plus adaptatives. Ce déplacement s’opère aussi dans la pratique. « Personnellement, je n’utilise presque jamais le mot intelligence, confie Anne-Lyse Demarchi. Je parle plutôt de compétences intellectuelles. » Dans une démarche clinique, ce sont les profils cognitifs, les forces et les fragilités de chacun qui priment sur un score global. Mais même dans ces approches plus nuancées, la question persiste : quelles dimensions choisit-on de mesurer ? Et pourquoi celles-là ?
Définir pour mieux classer ?
Pourquoi s’acharne-t-on à vouloir définir l’intelligence, malgré sa complexité, sa variabilité, son ancrage culturel ? Parce que ce mot, derrière sa façade scientifique, est profondément politique. Il classe, il trie, il distribue des rôles, des statuts, des places. « L’intelligence a souvent servi à justifier des hiérarchies, rappelle Jean-Michel Roy. Hiérarchies entre individus, entre cultures, entre types de savoirs. C’est un concept qui a été très instrumentalisé. »
Dès ses origines, la mesure de l’intelligence a accompagné des dispositifs de tri : orientation scolaire, dépistage de la « débilité », sélection militaire ou professionnelle… Aujourd’hui encore, les tests sont utilisés pour établir des diagnostics, attribuer des aménagements scolaires, justifier une prise en charge, ou guider une décision judiciaire. « Les outils d’évaluation reflètent une certaine idée de la normalité, souvent fondée sur des échantillons très standardisés, peu représentatifs de la diversité des profils », souligne Anna-Rita Galiano, enseignante-chercheuse en psychologie du développement à l’Université Lumière Lyon 2, spécialiste des situations de handicap. Le problème, c’est que ces normes sont rarement interrogées. On les applique comme des références objectives, alors qu’elles sont historiquement et culturellement situées. « Chaque tentative de définition de l’intelligence s’inscrit dans un cadre social, symbolique, parfois idéologique, insiste Mathieu Guillermin. Ce n’est pas un fait que l’on observe, c’est une idée que l’on construit. Et cette construction a des effets concrets. »
Par exemple, dans le champ du handicap, l’accès à certains droits dépend encore du seuil de QI. « Sans norme adaptée, certains profils sont mal évalués, voire exclus de dispositifs d’accompagnement », déplore Anna-Rita Galiano. La question de l’intelligence devient ici une barrière ou un levier, selon les cas. Mais pour elle, le véritable enjeu réside moins dans l’outil que dans la formation de ceux qui l’utilisent : « La psychométrie repose sur des principes solides, mais encore faut-il que les professionnels soient correctement formés à l’interprétation des résultats. Trop souvent, ces évaluations sont menées sans une réelle maîtrise des fondements théoriques. » Dans ces conditions, un test peut devenir aussi bien un outil de justice… qu’un facteur d’exclusion.
Mais la critique dépasse le cadre technique. Elle interroge nos choix collectifs : que valorise-t-on quand on parle d’intelligence ? La logique ? La mémoire ? L’efficacité ? L’adaptabilité ? La créativité ? La capacité à comprendre autrui ? « Mesurer l’intelligence, c’est toujours choisir ce que l’on considère comme important, rappelle Mathieu Guillermin. Et ce choix en dit long sur notre société. » Dans un monde où l’évaluation est partout, où la performance est un mot-clé, la question de l’intelligence agit comme un révélateur. Elle nous force à regarder ce que nous considérons comme désirable, utile, digne d’être reconnu. « L’intelligence, telle qu’on la mesure, reflète nos priorités culturelles, nos angles morts… et parfois nos injustices », conclut-il.
Impossible à cerner tout à fait, l’intelligence glisse entre les disciplines, les cultures, les mots. Elle est une construction mouvante, modelée par les contextes, les époques, les regards. Peut-être faut-il cesser de vouloir la définir… et apprendre à mieux la questionner.
Notes
[1] Aristote, De l’âme (De Anima), Livre III (vers 350 avant J.-C.).
[2] Binet, A., L’étude expérimentale de l’intelligence (1903).
[3] Dreyfus, H. L., What Computers Can’t Do: The Limits of Artificial Intelligence (1972).
[4] Searle, J. R, Minds, Brains, and Programs, Behavioral and Brain Sciences (1980).
[5] Le modèle de Cattell-Horn-Carroll (CHC) est une théorie qui décrit l’intelligence et les capacités cognitives humaines sous forme d’une structure hiérarchique, dans laquelle des facteurs étroits prédisent des facteurs cognitifs plus larges, qui eux-mêmes prédisent le facteur général d’intelligence, élément commun à tous les tests d’intelligence.
[6] Howard Gardner, psychologue du développement, propose, en 1983, la Théorie des intelligences multiples, identifiant huit formes d’intelligence distinctes : linguistique, logico- mathématique, spatiale, musicale, corporelle-kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. Cette théorie élargit la conception traditionnelle de l’intelligence en reconnaissant une diversité de compétences humaines.
POUR ALLER PLUS LOIN
- Mesurer l’intelligence : pour quoi faire ? par Marie Privé, Pop’Sciences Mag #15, été 2025.