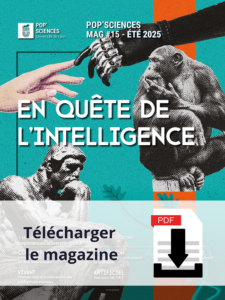Longtemps réduits à l’état de simples automates par la pensée cartésienne, les animaux sont désormais considérés comme des êtres sensibles dont les capacités de réflexion rivalisent parfois avec celles de notre propre espèce. Des primates aux insectes sociaux en passant par les corvidés et les céphalopodes, les prouesses cognitives des organismes vivants ne cessent de nous surprendre à mesure que progresse la recherche scientifique sur le comportement animal.
Par Grégory Fléchet, journaliste.
>> Version à feuilleter en ligne : cliquez ici
>> Ou téléchargez le pdf du Pop’Sciences Mag #15 :
Jusqu’à l’aube du 20e siècle, l’intelligence est demeurée un attribut que notre espèce se refusait d’accorder aux autres représentants du règne animal. Depuis lors, l’accumulation des découvertes dans le champ de l’éthologie, discipline qui étudie le comportement des animaux, a fait voler en éclat ce cloisonnement entre humains et non-humains. « Notre communauté scientifique s’accorde désormais sur le fait qu’il existe, non pas une, mais plusieurs formes d’intelligence animale, celles-ci pouvant être aussi bien de nature coopérative, innovante, émotionnelle, que culturelle », indique Florence Levréro, professeure en éthologie et bioacoustique dans l’Équipe de neuro-éthologie sensorielle, à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne.
Comme en témoignent ses propres recherches sur les grands singes, les capacités cognitives d’une espèce sont, par ailleurs, largement façonnées par l’environnement dans lequel l’animal évolue. Ainsi, pour les bonobos vivant à l’état sauvage dans les forêts équatoriales de la République démocratique du Congo, la cohésion et la coordination des déplacements au sein du groupe reposent principalement sur la communication vocale, particulièrement efficace à longue distance. « En milieu naturel, les membres d’un même groupe se perdant régulièrement de vue en raison de la densité du couvert forestier, les vocalisations permettent alors de maintenir les liens sociaux », explique Florence Levréro. Par ailleurs, contrairement aux macaques et aux babouins dont les vocalisations sont très stéréotypées, le registre vocal des bonobos, tout comme celui des chimpanzés, présente de subtiles variations. Chez ces deux espèces, il existe, en effet, toute une gamme de tonalités et de modulations que même l’oreille aguerrie des spécialistes en bioacoustique ne parvient pas à distinguer.
La subtilité des vocalisations révélée par l’IA
« En nous aidant de l’intelligence artificielle pour analyser plus finement un corpus d’enregistrements sonores de bonobos, nous cherchons à relier les subtiles variations acoustiques d’une même vocalisation à différents contextes de la vie sociale de ces primates tels que des contacts amicaux, la perception d’un danger ou un conflit entre congénères », détaille l’éthologue stéphanoise. Grâce à cette même méthode d’analyse basée sur l’apprentissage automatique, Florence Levréro et son équipe ont également mis en évidence une signature vocale propre à chaque individu. En poursuivant leurs investigations sur un plus grand jeu de données acoustiques, les chercheurs espèrent révéler la complexité, encore très largement sous-estimée, du répertoire vocal de ces grands singes.

Chez les bonobos, chaque individu possède une signature vocale qui lui est propre.© Licence Envato Visée.A
Cette diversité de vocalises est loin d’être restreinte à cette famille de primates. Chercheuse en éthologie au Laboratoire de psychologie sociale et cognitive (LAPSCO) de Clermont-Ferrand et spécialiste des corvidés, Valérie Dufour s’intéresse tout particulièrement aux colonies de corbeaux freux. « Une colonie de cette espèce pouvant compter des milliers d’individus appartenant eux-mêmes à des dizaines de groupes sociaux distincts, chaque oiseau doit non seulement être en mesure de signaler son identité à l’ensemble de la colonie, mais doit aussi préciser à quel groupe il appartient », explique la scientifique du LAPSCO. Les chercheurs ont notamment constaté que les mâles possédaient un répertoire d’une vingtaine de cris propre à chaque individu.
À l’instar de la communication verbale ou de la conscience de soi, attestée par le fameux test du miroir[1], la théorie de l’esprit constitue un autre trait cognitif qu’on a longtemps cru réservé à l’homme. Cette expression ne se réfère pas à une quelconque théorie scientifique, mais désigne la capacité d’un individu à pouvoir accéder à l’état de connaissance d’autres personnes au travers des émotions qu’elles expriment. Ces dernières années, plusieurs études ont montré que d’autres espèces étaient dotées de cette compétence. Outre la plupart des grands singes et le chien domestique, l’aptitude à prêter aux autres des états mentaux a été observée chez les corvidés (corbeaux, corneilles, pie, geai, etc.).
Les corbeaux façonnent leurs propres outils
Notoirement connus pour pratiquer la cache de nourriture, ces oiseaux se livrent aussi à l’espionnage de leurs semblables pour tenter d’identifier leurs cachettes. « Une corneille ou un grand corbeau, qui se sait observé par un congénère voleur, brouille les pistes lorsqu’il cache sa nourriture. Par ce comportement, les corvidés démontrent qu’ils peuvent comprendre le point de vue des autres afin d’agir en conséquence », précise Valérie Dufour.
Tout comme l’homme et d’autres primates, les corvidés interagissent également avec leur environnement physique à l’aide d’outils qu’ils manipulent pour accéder à une source de nourriture. Le corbeau calédonien est même capable de fabriquer ses propres instruments, de petits crochets en l’occurrence, qu’il façonne à partir de tiges de feuilles pour harponner des larves d’insectes dissimulées sous l’écorce des arbres. Dans le cadre d’expériences menées en laboratoire, cette espèce a prouvé qu’elle savait accomplir en un temps record et sans entraînement préalable des tâches complexes impliquant jusqu’à huit étapes successives. « Réaliser ce genre de prouesses témoigne d’un sens aigu de l’observation et d’une capacité d’apprentissage rapide, deux aptitudes cognitives que le réagencement permanent de l’organisation sociale[2] des corvidés a sans doute favorisées », souligne Valérie Dufour.

Les corbeaux freux mâles possèdent, eux aussi, un répertoire de cris propres à chaque individu. © Licence Envato Visée.A
Si la propension à interagir constamment avec ses semblables constitue sans nul doute un gage d’intelligence, le poulpe nous prouve que cette qualité est loin d’être indispensable. Livré à lui-même dès la naissance, ce céphalopode au tempérament solitaire est pourtant doté de remarquables capacités cognitives. « Parmi toutes les espèces animales qui peuplent le milieu marin, les céphalopodes sont les seuls qui manipulent des objets avec dextérité. Et grâce aux ventouses qui tapissent la face interne de leurs bras, ils peuvent littéralement “goûter” ces mêmes objets par le toucher », détaille Ludovic Dickel, professeur d’éthologie à l’Université de Caen Normandie qui étudie le comportement de ces animaux au sein du laboratoire EthoS – Éthologie animale et humaine.
Le cerveau à la fois centralisé et périphérique du poulpe
Proches parents des escargots et des huîtres, les céphalopodes sont toutefois bien mieux dotés sur le plan cérébral. Avec un système nerveux constitué de 300 à 500 millions de neurones, contre à peine 900 000 pour un escargot, poulpes et seiches disposent d’une architecture cérébrale bien plus sophistiquée que n’importe quel autre invertébré. Mais plus que par la taille de leur cerveau, qui équivaut à celui d’une souris, les céphalopodes se démarquent par l’organisation à la fois centralisée et périphérique de celui-ci : un cerveau principal situé entre les deux yeux communique en permanence avec huit cerveaux plus petits logés à la base de chacun de leurs huit bras. C’est d’ailleurs cet agencement si particulier qui confère à ces organismes vivants leur exceptionnelle agilité motrice et sensorielle.

Les céphalopodes (ici une pieuvre commune) peuvent « goûter » les objets par le toucher grâce à leurs ventouses.
Les céphalopodes excellent également dans l’art du camouflage. « Leur corps et leurs bras n’étant pas circonscrits à un squelette, ils sont en mesure de le modeler à leur guise pour prendre l’apparence d’une algue ou d’un rocher et passer ainsi inaperçus, illustre Ludovic Dickel. En activant leurs chromatophores[3], ils peuvent, en outre, reproduire la couleur et la texture de n’importe quel type de support. » Chez les seiches, ces variations chromatiques reposant sur la polarisation de la lumière, que ces animaux sont les seuls à percevoir, servent aussi à communiquer entre congénères sans que de potentiels prédateurs s’en aperçoivent. Les motifs colorés arborés par ces animaux pourraient également refléter leur état émotionnel selon de récents travaux menés par l’équipe de Ludovic Dickel. « Lorsqu’une seiche placée dans un aquarium est confrontée à une situation positive, la possibilité d’accéder à de la nourriture en l’occurrence, nous avons pu constater qu’elle présentait des motifs colorés particuliers. Si la source de nourriture proposée est une crevette, proie que le céphalopode apprécie tout particulièrement, ces mêmes motifs vont s’exprimer avec plus d’intensité. » En présence de congénères, la seiche serait même capable de réfréner cette émotion positive que constitue le changement de coloration afin de ne pas révéler la présence de cette proie appétissante aux autres céphalopodes.
[Le corps et le bras des céphalopodes] n’étant pas circonscrits à un squelette, ils sont en mesure de le modeler à leur guise pour prendre l’apparence d’une algue ou d’un rocher et passer ainsi inaperçus.
Ludovic Dickel Professeur d’éthologie à l’Université de Caen Normandie et au sein du laboratoire EthoS – Éthologie animale et humaine.
L’abeille domestique apprend à danser
Ressentir des émotions ou résoudre des problèmes complexes n’est pas qu’une affaire de gros cerveau. Les insectes sociaux, (abeilles, guêpes, bourdons, fourmis, termites…) en sont la parfaite illustration. Dotée d’un cerveau pas plus grand qu’un grain de semoule, l’abeille domestique est pourtant capable de compter, saisir les concepts de similitude et de différence ou d’apprendre des tâches complexes en observant les autres abeilles. « On a longtemps pensé que la danse, que ces insectes exécutent pour indiquer à leurs congénères la localisation d’une source de nourriture, était innée. Or, une étude a récemment montré que ce sont les ouvrières les plus âgées de la ruche qui apprennent à danser aux plus jeunes, un peu comme si ces dernières allaient à l’école », développe Mathieu Lihoreau, directeur de recherche CNRS au Centre de biologie intégrative de Toulouse. Ce scientifique étudie plus particulièrement le comportement des insectes pollinisateurs dans des conditions expérimentales proches de leur milieu naturel. Il a ainsi pu observer qu’un bourdon était capable d’apprendre à optimiser son trajet pour visiter les fleurs d’un champ : passant de 2 km à 300 m en quatre heures. « Le fait qu’il faille plusieurs heures et de nombreuses tentatives à un bourdon pour établir cette route optimale prouve que cet insecte ne dispose pas d’une carte cognitive dans son cerveau pour accomplir cette tâche, souligne Mathieu Lihoreau. Comme les autres hyménoptères[4] sociaux, cet insecte doit vraisemblablement recourir à des stratégies moins sophistiquées telles que la mémorisation de points de repères stratégiques au cours de ses vols successifs. »
Qu’ils vivent au sein de colonies plus ou moins complexes, comme l’abeille domestique et les bourdons, ou adoptent un mode de vie solitaire comme les milliers d’espèces d’abeilles sauvages qui peuplent nos campagnes, les hyménoptères ont tous en commun de disposer d’un cerveau ultra-optimisé concentrant un million de neurones dans un volume d’à peine 1 mm3. Cette miniaturisation à l’extrême pourrait toutefois constituer le talon d’Achille de ces espèces, comme le redoute Mathieu Lihoreau : « Certains de nos travaux ont montré qu’une seule exposition à une très faible concentration de substances toxiques telles que le mercure ou l’arsenic suffisait à altérer les capacités intellectuelles des abeilles. » Or, si nous ne parvenons pas à préserver les aptitudes cognitives exceptionnelles de ces insectes pollinisateurs, dont dépend la reproduction d’un grand nombre de plantes essentielles à notre alimentation, c’est notre propre santé que nous risquons de mettre en péril.
Notes
[1] Développé par un psychologue américain dans les années 1970, ce test consiste à placer un animal devant un miroir et observer ses réactions pour vérifier s’il a conscience de lui-même.
[2] Chez la corneille noire, par exemple, cette organisation évolue au fil du temps. Les juvéniles de cette espèce se regroupent en bandes de dizaines d’individus. Une fois adulte, la corneille noire vit ensuite en couples territoriaux stables et sédentaires. Au début de l’hiver, ces couples rejoignent de grands rassemblements pouvant compter plusieurs milliers de corvidés de différentes espèces.
[3] Cellules de pigmentation présentes dans l’épiderme superficiel de certains animaux à sang froid (céphalopodes, amphibiens, reptiles…) capables d’induire des variations de couleur, notamment sous l’effet de contractions musculaires.
[4] Grand groupe d’insectes possédant deux paires d’ailes membraneuses auquel appartiennent notamment, les abeilles, les fourmis, les bourdons et les guêpes.
Humains-animaux : vivre en bonne intelligence
Quelles sont les formes d’intelligence animale ? Quels seraient les traits communs entre l’intelligence humaine et les intelligences animales ? Cette nouvelle compréhension permet-elle une cohabitation plus harmonieuse humains-vivant ?
Découvrez un échange autour des intelligences humaines et animales entre Florence Levréro, professeure en éthologie et bioacoustique à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, et Anna Rita Galiano, professeure en psychologie du handicap à l’Université Lumière Lyon 2.
POUR ALLER PLUS LOIN
- Lihoreau, M., La planète des insectes, Éditions Tana (2025).
- Dickel, L., La vie privée du poulpe, Éditions humenSciences (2022).
- Marmion, J.-F., (dir.), Psychologie des animaux, Sciences Humaines Éditions (2022).
- L’intelligence végétale, un sujet sensible, par Grégory Fléchet, Pop’Sciences Mag #15, été 2025.