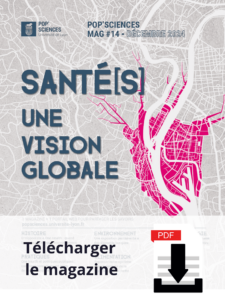Les choix que nous faisons en matière d’alimentation et de production agricole influencent non seulement notre santé, mais aussi celle de l’environnement qui nous entoure. Au-delà de l’impérieuse nécessité de diminuer notre consommation de produits transformés, de sucre ou de viande rouge, c’est l’ensemble du modèle actuel qu’il s’agit de réinventer de fond en comble pour notre bien-être et celui de la planète.
Par Grégory Fléchet, journaliste.
>> Version à feuilleter en ligne : cliquez ici
>> Ou téléchargez le pdf du Pop’Sciences Mag #14 :
À l’époque de la Grèce antique, Hippocrate considérait que notre alimentation devait être notre premier remède. Près de deux mille cinq cent ans plus tard, la recommandation pleine de bon sens du père de la médecine semble malheureusement avoir fait long feu. En février 2024, une étude[1] publiée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet annonçait, en effet, que le seuil du milliard d’êtres humains souffrant d’obésité venait d’être franchi : soit deux fois plus qu’il y a vingt ans. Dans ce même laps de temps, d’autres pathologies résultant de déséquilibres alimentaires, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou certains cancers, suivaient la même tendance à la hausse. À tel point qu’un décès sur cinq dans le monde est aujourd’hui lié à une mauvaise alimentation.
En France, comme dans les autres pays dits « développés », ces maladies résultent le plus souvent d’une consommation insuffisante d’aliments riches en fibres comme les fruits et les légumes et d’un excès d’aliments pouvant alors se révéler néfastes pour notre organisme, tels que la viande rouge et la charcuterie. « Alors que le Plan national nutrition santé recommande de consommer moins de 500 g de viande rouge par semaine, un tiers des français dépassent ce seuil hebdomadaire. En ce qui concerne la ration quotidienne de fibres alimentaires, le constat est encore plus préoccupant puisque 90 % n’atteignent pas les 30 g par jour recommandés par l’Organisation mondiale de la santé », détaille Michel Duru, directeur de recherche INRAE au sein de l’Unité AGIR (AGroécologie – innovations – TeRritoires) qui explore depuis fort longtemps le concept One Health. Définissant les santés humaines, animales et environnementales comme étant étroitement liées et interdépendantes, cette approche est alors centrale dans le champ de l’alimentation. Modifier nos habitudes alimentaires en se fixant comme objectif de consommer moins de viande et davantage de produits riches en fibres et en micronutriments (oméga 3, vitamines…) nécessite de restructurer notre système alimentaire du champ à l’assiette.
Accorder plus de place aux protéines végétales
En amont des chaînes d’approvisionnement et de transformation, il s’agit en premier lieu de consacrer davantage de surfaces cultivées à la production de fruits et légumes, ainsi qu’aux légumineuses destinées à l’alimentation humaine comme les lentilles, les haricots secs et les pois chiches. « Pour satisfaire la consommation nationale de fruits et de légumes sans avoir recours aux importations de ces denrées, il faudrait, par exemple, doubler la surface dédiée à ces cultures, soit 700 000 hectares supplémentaires, indique Michel Duru. Afin de répondre à la demande en protéines végétales, la surface des légumineuses devrait, quant à elle, passer de 70 000 à 350 000 hectares. » Aussi ambitieuses qu’elles puissent paraître, ces hausses de superficie sont loin d’être irréalistes. Mises bout à bout, elles restent, en effet, inférieures aux 1,4 million d’hectares de maïs-fourrage que la France consacre chaque année à l’alimentation de ses bovins. Or, ce cheptel reste trop important au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Selon un rapport[2] de la Cour de comptes publié l’an dernier, les 17 millions de bovins que compte notre pays sont responsables de 12 % du total des émissions de GES de la France, principalement à cause du méthane qu’ils produisent pendant la phase de digestion. Réduire la taille de ce cheptel contribuerait non seulement à lutter contre le réchauffement climatique, mais pourrait aussi inciter les français à adopter une alimentation plus saine. « Sachant que pour être en accord avec les recommandations nutritionnelles, il conviendrait de diviser par deux notre consommation de viande rouge et un peu celle de produits laitiers, cantonner l’élevage bovin aux presque 12 millions d’hectares de prairies avec un complément limité de cultures [telles que le maïs et le colza, NDLR] suffirait amplement à satisfaire la consommation nationale dans une perspective One Health », assure Michel Duru.
Les aliments que nous consommons ne nous fournissent pas toujours les nutriments essentiels dont nous avons besoin pour nous maintenir en bonne santé. Il y a, tout d’abord, le cas extrême des aliments ultra-transformés qui constituent désormais près d’un tiers de nos apports caloriques journaliers. Ingérée de façon régulière, cette nourriture, qui se révèle souvent de piètre qualité, augmente le risque de surpoids ou celui de développer des maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle.
Réinterroger la qualité nutritive de nos aliments
Pour se prémunir de tels risques, le ministère de la Santé préconise de consommer cinq fruits et légumes par jour. Bien que leur consommation soit essentielle, la qualité de certains fruits et légumes n’est malheureusement pas toujours optimale. En privilégiant les rendements au détriment des qualités gustatives et nutritives, l’agriculture dite « conventionnelle » a, en effet, contribué à amoindrir la concentration en vitamines, protéines et autres antioxydants[3] de la majorité des plantes que nous consommons.
Ces dernières années, plusieurs travaux scientifiques ont confirmé une diminution parfois spectaculaire de certains nutriments essentiels comme, le calcium ou le phosphore. Une étude[4] publiée en 2007 par le Worldwatch Institute, une organisation environnementale américaine, affirmait même qu’une pomme Golden Delicious des années 2000 contenait 100 fois moins de vitamine C qu’une variété rustique cultivée dans les années 1950. Bien que les conclusions de cette étude comparative restent sujettes à caution, le taux de vitamine C d’une pomme étant conditionné par de nombreux facteurs comme la variété, le niveau d’ensoleillement ou la maturité du fruit au moment de sa récolte, elle témoigne, malgré tout, des effets délétères de la rentabilité à toute épreuve encouragée par l’agro-industrie. « Alors que dans un verger moderne de type intensif les pommiers sont plantés tous les 70 cm, le verger extensif des années 1950 ménageait une distance de 10 m entre chaque arbre. Cette configuration ayant pour effet d’amplifier l’interaction entre les microorganismes du sol et le système racinaire des pommiers, ceux-ci étaient en mesure d’y puiser une plus grande quantité de nutriments », précise l’ethnobotaniste Stéphane Crozat qui dirige par ailleurs le Centre de Ressources de Botanique Appliquée (CRBA) de Charly (Rhône).
Miser sur la diversité et la relocalisation
Pendant des siècles, la sélection des plantes cultivées fut opérée à l’échelle de chaque exploitation agricole. Cette méthode empirique avait un but bien précis : veiller à ce que les variétés de fruits, légumes ou céréales disposent de caractéristiques génétiques adaptées à leur lieu de culture. Avec l’avènement de l’agriculture industrielle, cette diversité variétale a progressivement disparu pour laisser la place à des semences standardisées adaptées à une très grande diversité d’environnements. Selon l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 80 % des légumes et céréales cultivés il y a 50 ans auraient ainsi disparu. En France, dix variétés de blé tendre assurent à elles seules la moitié de la production nationale de cette céréale. Sur les hauteurs de la ville de Charly, le CRBA s’efforce de lutter contre cette uniformisation progressive en remettant au goût du jour des variétés anciennes cultivées selon les préceptes de l’agriculture biologique. « Pour contrecarrer la baisse progressive des rendements agricoles, liée à la fois à l’épuisement des sols, à l’usage immodéré de produits phytosanitaires[5] et aux bouleversements climatiques, nous misons sur une relocalisation de l’agriculture basée sur la coévolution[6] entre les plantes et leur terroir », plaide Stéphane Crozat.
À Lyon, un groupe de scientifiques du laboratoire CarMeN[7] réunis autour de Marie- Caroline Michalski remet sur le devant de la scène un aliment d’une toute autre nature : le babeurre. Principal ingrédient du sarasson, une préparation fromagère typique de la région stéphanoise, le babeurre est un coproduit[8] de la fabrication du beurre que l’industrie laitière française ne valorise plus. Or, cette substance naturelle présente un véritable intérêt pour la santé comme le souligne la directrice de recherche à l’INRAE : « Nous avons montré que la consommation quotidienne d’une portion de fromage à tartiner enrichi en babeurre réduisait la concentration dans le sang de plusieurs marqueurs du risque cardiovasculaire, dont le cholestérol LDL, chez des femmes ménopausées en surpoids, qui constituent une population particulièrement exposée à ce risque. » L’action bénéfique du babeurre résulte de sa capacité à freiner l’absorption intestinale du cholestérol. Elle découle également de son aptitude à « nourrir » le microbiote intestinal, favorisant ainsi la production de composés ayant un effet bénéfique sur le métabolisme du cholestérol. Des études précliniques complémentaires suggèrent aussi un effet protecteur vis-à-vis de phénomènes inflammatoires associés à une mauvaise alimentation. De là à faire du babeurre un nouvel allié pour notre santé, il n’y a qu’un pas qui pourrait vite être franchi.
Notes
[1] Phelps, N. H., et al., Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults, The Lancet (2024).
[2] Les soutiens publics aux éleveurs de bovins, Cour des comptes (2023).
[3] Ensemble de molécules qui participent à la lutte contre le stress oxydatif responsable du vieillissement cellulaire.
[4] Halweil, B., Still No Free Lunch: Nutrient levels in U.S. food supply eroded by pursuit of high yields, The Organic Center (2007).
[5] Substances chimiques ou naturelles qui visent à protéger les végétaux des attaques des organismes nuisibles, comme les champignons, les insectes ou les mauvaises herbes.
[6] La coévolution désigne l’adaptation réciproque entre espèces qui interagissent entre elles dans un équilibre dynamique.
[7] Cette unité mixte de recherche (Inserm/INRAE/ Université Claude Bernard Lyon 1) mène des travaux sur les maladies cardiovasculaires, le métabolisme, la diabétologie et la nutrition.
[8] Selon l’Ademe, un coproduit est une matière qui est créée au cours même du processus de fabrication d’un produit, que ce soit de façon intentionnelle ou non. Le coproduit est destiné à un usage particulier, distinct de celui du produit dont il est issu.
POUR ALLER PLUS LOIN
- Le CRBA sème les graines du futur de l’agriculture, par Grégory Fléchet, Pop’Sciences Mag #14, décembre 2024.
- Dufour, A., et Garnier, C., Le régime One Health, Éditions Leduc (2021).
- Duru, M., et Therond, O., One Health (Une seule santé) pour concevoir des alternatives crédibles aux défaillances des systèmes alimentaires, Cahiers agricultures, n°18 (2024).
- Soler, L.-G. (coord.), Vers des systèmes alimentaires sains et durables : quand la recherche accompagne la transition, INRAE (2020).